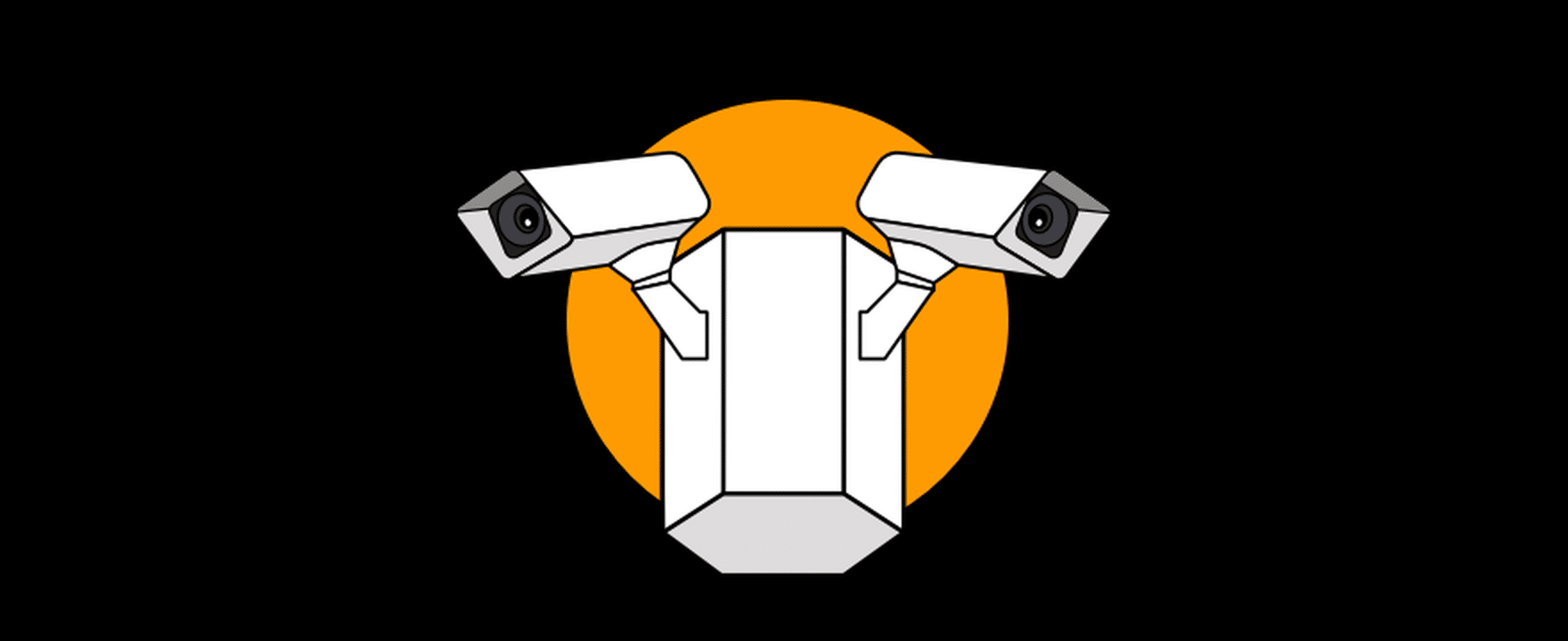Nerf de la guerre économique, la confidentialité n’est plus ce qu’elle était : avec WikiLeaks, le Pentagone en sait quelque chose. Mais les chefs d’entreprise savent-ils tout ce qui se dit sur Facebook, où des responsables commerciaux ou R&D commentent leur semaine avec moult détails qui intéresseront vivement les amis d’amis… de la concurrence ?
Distincte de la clause de non-concurrence, l’obligation du même nom est inhérente au contrat de travail : on ne peut être à la fois collaborateur et concurrent. La chambre sociale y veille, avec faute grave, voire lourde, à la clé : « En violation de ses obligations contractuelles, M. X avait volontairement transmis à des personnes extérieures à l’entreprise des courriers électroniques contenant des informations confidentielles : ce manquement constituait une faute grave. » (17 mars 2010.)
Le très méconnu article L. 1227-1 du Code du travail réprime « le fait, pour un directeur ou un salarié, de révéler ou de tenter de révéler un secret de fabrication, puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros ». Mais il ne faut pas confondre secret de fabrication et simple obligation de confidentialité, comme le rappelle en deux temps L. 2325-5 : « Les membres du comité d’entreprise sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication. Ils sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur »; l’arrêt KPMG du 12 juillet 2006 y a ajouté une troisième condition : le procès-verbal de la réunion du comité doit expressément mentionner que ces informations ont été données comme confidentielles : bref leur donner un minimum de publicité en nos temps de folles rumeurs au sein du village mondial qu’est le World Wild Web.
L’affaire Renault : espionnage et pieds nickelés
Le feuilleton Renault est un magnifique cas pratique pour un étudiant en droit. Voilà une entreprise soumise à une concurrence internationale féroce apprenant par un courriel anonyme que trois de ses dirigeants la trahissent. Elle mène pendant plusieurs mois une enquête interne dont on imagine les méthodes (par exemple, l’analyse détaillée de tous les flux informatiques des personnes concernées). Investigations donnant, semble-t-il, des résultats probants, sauf pour un juge civil n’acceptant aucune preuve illégale car déloyalement obtenue.
Principe rappelé par l’assemblée plénière le 7 janvier 2011 : « L’enregistrement d’une communication téléphonique réalisé à l’insu de l’auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve. »
Et le communiqué de presse d’ajouter : « La plus haute formation de la Cour marque ainsi son attachement au principe de la loyauté qui participe pleinement à la réalisation du droit fondamental de toute partie à un procès équitable. Mais fondant la cassation sur le visa de l’article 9 du Code de procédure civile, elle affirme sans ambiguïté son attachement au maintien de la jurisprudence de la chambre criminelle tenant compte de la spécificité de la procédure pénale. »
Car, plus réaliste sur la nature humaine de par ses fonctions, cette dernière refuse que la déloyauté dans l’obtention d’une preuve puisse conduire à l’impunité du fautif.
LES RISQUES D’UNE ENQUÊTE FAÇON 007
Dans les rapports de travail, laisser les baroudeurs responsables de la sécurité utiliser en amont de créatives méthodes d’investigation aboutit souvent à transformer le coupable en victime, et la victime réelle en accusé : violation de la correspondance, atteinte à la vie privée par enregistrements ou films (226-1 du Code pénal) et violation quasi assurée de la loi informatique et libertés avec ses redoutables sanctions : « Le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. » (226-18 CP.)
Voilà sans doute l’explication des palinodies de notre grand constructeur lorsqu’il s’est agi de justifier les trois licenciements pour faute lourde : « Notre conviction est que vous avez donné des informations stratégiques pour l’entreprise » ne convaincra pas le juge : il faut des preuves, et du solide… Mais peut-être la direction s’était-elle placée dans une logique de gestion des risques juridiques : stopper les fuites, quel qu’en soit le prix, et trois licenciements sans cause réelle et sérieuse…
Alors bien sûr, il est ensuite tentant de blanchir ces preuves gris foncé en faisant appel à la police puis au juge pénal qui, lui, n’écarte pas les preuves déloyalement obtenues (« Les moyens de preuve produits par les parties ne peuvent être écartés des débats au seul motif qu’ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale ; il appartient seulement aux juges d’en apprécier la force probante après les avoir soumis à la discussion contradictoire »), et dont par ailleurs les décisions qui en découlent s’imposent au juge civil. Mais, pour ces affaires sensibles nécessitant un maximum de confidentialité, la suite n’est faite que de chausse-trappes.
L’on s’aperçoit d’abord, mais un peu tard, que la Direction centrale du renseignement intérieur (devenue DGSI) et aussi nombre d’officiers de police judiciaire adorent les journalistes, qui le leur rendent bien dans la guerre au scoop. Ensuite, que le secret de l’instruction n’empêche pas un journal du soir de publier à 15 heures ce qui a été dit dans le bureau du juge à 10 h 30. Enfin,quelerespectdu contradictoire à l’occasion du procès met l’essentiel des informations sur la place publique : pas de possibilité de huis clos ici. D’où l’importance d’une bonne communication sous contrainte judiciaire (une communication de crise adaptée aux contraintes des affaires judiciaires et à la communication des avocats).
Et si l’on oublie ce chemin de croix pour les services de recherche et développement et de sécurité, la sanction judiciaire est in fine souvent ridicule, nombre de magistrats ne mesurant pas les enjeux en cause.
Ainsi de la décision Michelin du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand du 21 juin 2010 : un ingénieur démissionnaire avait bourré son disque dur d’informations confidentielles, puis tenté de les vendre à la concurrence japonaise. Seulement, tout à fait exemplaire, cette dernière avait prévenu Michelin : deux ans de prison avec sursis, 5 000 euros d’amendeet 10 000 euros de dommages et intérêts. Mais au seul titre du bon vieux abus de confiance, car échec sur l’atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation (« La concurrence entre entreprises relevant de la seule sphère privée, elle n’engage donc pas un intérêt public légalement protégé »), échec également sur la violation des secrets de fabrication. Réaction : la proposition de loi de janvier 2011 sur « les informations à caractère économique protégées ». Aimez-vous les oxymores ?
INTERNET ET CONFIDENTIALITÉ
En novembre 2004, un site syndical met en ligne des informations jugées confidentielles par la société TNS Secodip. Se fondant sur une obligation de discrétion et de confidentialité des syndicats, le TGI de Bobigny ordonne le 11 janvier 2005 la suppression des pages litigieuses. Mais la cour d’appel de Paris infirme le 15 juin 2006 : ces obligations auxquelles sont tenus les représentants du personnel ne peuvent s’étendre au syndicat.
Cassation le 5 mars 2008, soit… quarante et un mois après les faits, au visa de deux textes logiquement étrangers au droit du travail puisque cette communication externe n’en relève pas : l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, et l’article 1 de la loi du 21 juin 2004 : « Si un syndicat a le droit de communiquer librement des informations au public sur un site Internet, cette liberté peut être limitée dans la mesure de ce qui est nécessaire pour éviter que la divulgation d’informations confidentielles porte atteinte aux droits des tiers. En ne recherchant pas si les informations litigieuses avaient un caractère confidentiel, et si ce caractère était de nature à justifier l’interdiction de leur divulgation au regard des intérêts légitimes de l’entreprise, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » Cette pesée en deux temps des intérêts en présence semble a priori légitime, mais le débat judiciaire initial, donc public sinon médiatisé, sur « le caractère confidentiel des informations litigieuses » paraît surréaliste.
1. Le juge doit d’abord « rechercher si les informations litigieuses avaient un caractère confidentiel ». Au-delà de la vaste culture économique et technologique des magistrats, ce premier exercice s’avère délicat. Si les informations en cause proviennent d’une réunion du comité d’entreprise pour laquelle l’employeur avait expressément requis une entière confidentialité (avec note sur le P-V, information exclusivement orale, dépôt des téléphones portables à l’entrée, interdiction d’utiliser les ordinateurs en mode réseau) et qu’il démontre à la barre, mais devant la concurrence ravie, le bien-fondé de cette limitation, le juge n’aura guère de difficultés.
Mais, à côté des données vraiment stratégiques dont on se demande si un chef d’entreprise prendra le risque de les divulguer (cf. article 6-2 de la directive du 11 mars 2002 : « Dans des cas spécifiques et des limites fixées par les législations nationales, l’employeur n’est pas obligé de communiquer aux représentants du personnel des informations lorsque leur nature est telle que, selon des critères objectifs, elles entraveraient gravement le fonctionnement de l’entreprise ou lui porteraient préjudice »), existent aussi des informations sensibles qui, sorties de l’entreprise et de leur contexte, peuvent, dans notre société de la réputation, coûter cher en termes d’image sinon d’e-réputation : ainsi du vif débat d’octobre 2007 entre Renault et le CHSCT de Guyancourt à propos du rapport d’expertise relatif aux suicides.
2. Le caractère confidentiel des informations étant acquis, « était-il de nature à justifier l’interdiction de leur divulgation au regard des intérêts légitimes de l’entreprise » ? Ce second examen en forme de contrôle de proportionnalité (liberté d’expression et de communication/protection des intérêts vitaux de l’entreprise) paraît étrange. Car, si le mot confidence a encore un sens (« sous le sceau du secret »), on voit mal un juge énoncer d’abord que ces informations étaient très hautement confidentielles pour ensuite admettre qu’un site Internet les mette en ligne, à la disposition du monde entier.
Loi anti-WikiLeaks
La proposition de loi déposée le 13 janvier 2011 à l’Assemblée nationale veut créer un délit « d’atteinte au secret d’une information à caractère économique protégée », beaucoup plus large que l’article L. 1227-1 du Code du travail ne visant que « les secrets de fabrication ». Serait « puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 37 500 euros d’amende le fait pour toute personne non autorisée par le détenteur ou par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur de s’approprier, de conserver, de reproduire ou de porter à la connaissance d’un tiers non autorisé une information à caractère économique protégée ou de tenter de s’approprier, de conserver, de reproduire ou de porter à la connaissance d’un tiers non autorisé une information à caractère économique protégée » (article 226-14-1 du Code pénal).
Et, comme l’a rappelé, au visa de 1134 du Code civil, le TGI de Béthune le 14 décembre 2010 à un ex-salarié ayant mis en ligne des informations sensibles de son ex-employeur, une clause contractuelle de confidentialité survit à l’extinction du contrat : réparation en nature avec publication dans quatre journaux à hauteur de 10 000 euros et suppression sur le Web des textes en cause.