- Pourquoi la crise fabrique des dilemmes
- Premier dilemme : parler vite ou parler vrai
- Deuxième dilemme : transparence ou protection (juridique, stratégique, humaine)
- Troisième dilemme : empathie ou responsabilité (la peur de “reconnaître une faute”)
- Quatrième dilemme : contrôler le récit ou accepter la polyphonie
- Cinquième dilemme : parler d’une seule voix ou refléter la complexité interne
- Sixième dilemme : protéger l’interne ou rassurer l’externe
- Septième dilemme : rassurer ou inquiéter (l’équilibre du risque)
- Huitième dilemme : la preuve ou la narration (données vs histoire)
- Neuvième dilemme : attaquer la critique ou reconnaître la part de vérité
- Dixième dilemme : l’excuse publique ou la réparation silencieuse
- Onzième dilemme : la communication comme bouclier ou comme outil de gouvernance
- Douzième dilemme : l’éthique de la persuasion (influencer sans manipuler)
- Treizième dilemme : le leadership incarné ou la prudence institutionnelle
- Quatorzième dilemme : gérer la crise immédiate ou préparer l’après-crise
- Quelques principes pour naviguer entre ces dilemmes
- Le dilemme comme révélateur de culture
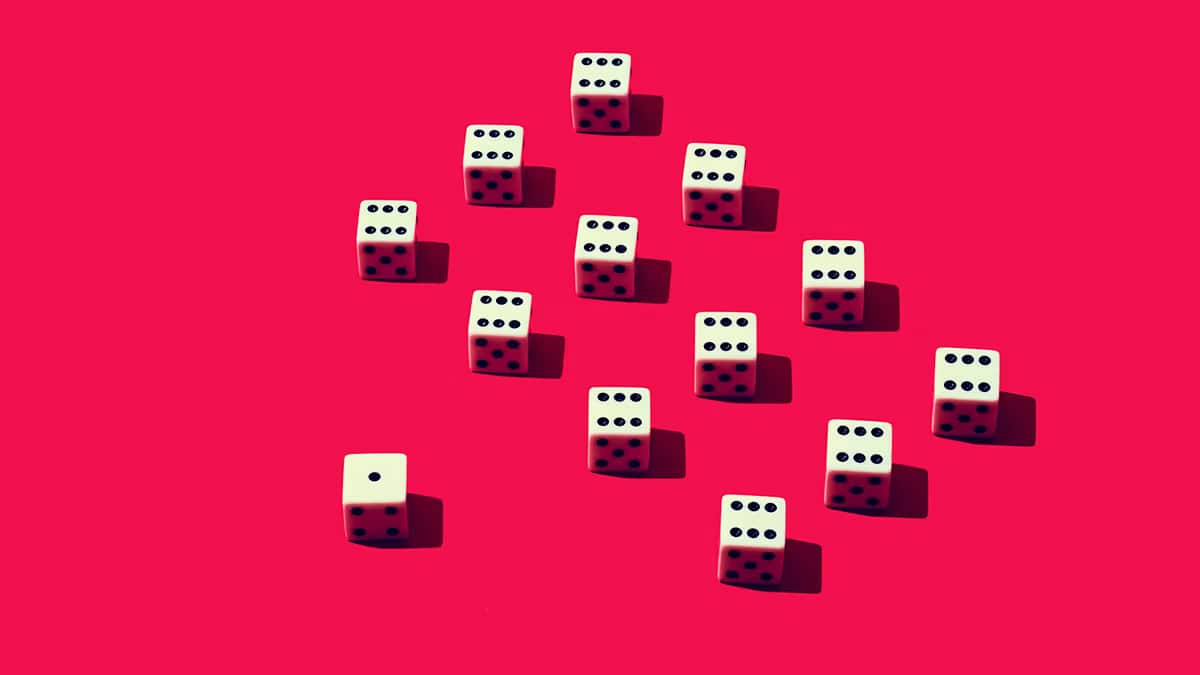
La communication de crise est souvent décrite comme un exercice de “gestion de l’urgence”. C’est vrai, mais réducteur. Elle est surtout une discipline de la décision sous contraintes, où l’organisation doit parler alors même qu’elle ne sait pas tout, qu’elle se sent menacée, et qu’elle est observée de toutes parts rappelle l’expert en communication de crise Florian Silnicki, Président Fondateur de l’agence LaFrenchCom. Le communicant de crise n’est pas seulement un “porte-voix” chargé d’émettre des messages : il se situe au carrefour de l’éthique, du juridique, de l’opérationnel, de la réputation, et des attentes sociales. Dans cette zone de turbulence, les dilemmes ne sont pas des accidents : ce sont des constantes. Chaque prise de parole engage la crédibilité future, influence le cours des événements, et révèle la culture profonde de l’organisation.
Ce texte propose une exploration des dilemmes structurants de la communication de crise. Il ne s’agit pas d’une liste de “bons réflexes” ou de formules à réciter, mais d’une cartographie des tensions récurrentes et des arbitrages difficiles : dire vite ou dire juste, être transparent ou se protéger, exprimer l’empathie sans se condamner, contrôler le récit sans tomber dans la manipulation, parler d’une seule voix sans effacer la complexité. Comprendre ces dilemmes, c’est déjà progresser : dans une crise, la lucidité sur les contraintes est un levier de maîtrise.
Pourquoi la crise fabrique des dilemmes
Une crise n’est pas seulement un événement grave. C’est une situation marquée par quatre caractéristiques qui, combinées, rendent la communication intrinsèquement paradoxale :
- L’incertitude : les faits sont incomplets, évolutifs, parfois contradictoires.
- La pression temporelle : les publics demandent des réponses immédiates, les médias bouclent, les réseaux s’emballent.
- L’asymétrie d’information : certains acteurs savent (ou croient savoir) des choses que d’autres ignorent ; des témoins diffusent des images avant toute vérification.
- La dimension émotionnelle : peur, colère, indignation, douleur, sentiment d’injustice.
Dans un tel contexte, chaque mot a un coût. Un silence peut être interprété comme une dissimulation. Une parole trop rapide peut devenir un mensonge involontaire. Une parole trop prudente peut paraître froide. Et, surtout, l’organisation doit communiquer tout en agissant. Or l’action est souvent lente, technique, complexe ; la parole, elle, est immédiate et publique. La crise met donc à nu une tension fondamentale : l’écart entre le temps des opérations et le temps de l’opinion.
Premier dilemme : parler vite ou parler vrai
L’un des dilemmes les plus fréquents est celui de la vitesse. Dans l’espace médiatique contemporain, l’absence de message laisse un vide que d’autres vont remplir : concurrents, opposants, témoins, influenceurs, politiques, experts autoproclamés. Le “premier récit” s’installe très vite et conditionne la suite. Pourtant, parler trop tôt expose à plusieurs risques :
- L’erreur factuelle : un chiffre faux, une chronologie inexacte, une cause mal identifiée.
- La contradiction : ce que l’on affirme à 10h sera corrigé à 14h ; le public retient surtout l’incohérence.
- La promesse impossible : annoncer une solution rapide qui ne sera pas tenue aggrave la colère.
La sortie de ce dilemme ne consiste pas à choisir la vitesse contre la vérité, mais à distinguer ce que l’on sait, ce que l’on ne sait pas, et ce que l’on fait. Une communication efficace peut être rapide sans être aventureuse, à condition d’assumer une forme de sobriété : reconnaître l’incertitude, annoncer des étapes, donner un rendez-vous de mise à jour, expliquer le processus de vérification. On appelle parfois cela “communiquer sur la méthode” : ce n’est pas un aveu de faiblesse, c’est une preuve de sérieux.
Un principe pédagogique utile : ne pas confondre exactitude et exhaustivité. Au début, on n’a pas tout ; mais on peut dire juste sur ce que l’on a.
Deuxième dilemme : transparence ou protection (juridique, stratégique, humaine)
La transparence est devenue une valeur sociale cardinale. Les organisations sont attendues sur l’honnêteté, l’ouverture, la capacité à rendre des comptes. Mais la transparence absolue est souvent impossible ou dangereuse :
- Contraintes juridiques : enquêtes en cours, secret de l’instruction, obligations de confidentialité, devoir de réserve, risques contentieux.
- Contraintes de sécurité : divulguer des détails techniques peut exposer à de nouveaux risques (cyberattaque, menaces, sabotage).
- Contraintes humaines : respecter la vie privée des victimes, protéger les salariés, éviter la stigmatisation.
- Contraintes stratégiques : des informations sensibles peuvent impacter la valeur, les négociations, ou servir d’armes à des adversaires.
Le dilemme n’est pas “dire tout” ou “ne rien dire”. Il est plutôt : comment être transparent sur l’essentiel sans nuire à la justice, à la sécurité et aux personnes ? Ici, l’erreur classique est la “transparence performative” : donner beaucoup de détails secondaires pour masquer le manque de clarté sur l’essentiel. Le public n’est pas dupe : il perçoit l’esquive.
Une approche robuste consiste à définir trois cercles d’information :
- Cercle public : ce qui peut être dit immédiatement, car vérifié et sans risque.
- Cercle conditionnel : ce qui pourra être dit plus tard (après validation, après enquête, après accord).
- Cercle protégé : ce qui ne peut pas être dit (et pourquoi).
Dire “je ne peux pas répondre à cela pour telle raison” est souvent préférable à un contournement. La protection peut être légitime ; la dissimulation, elle, détruit la confiance.
Troisième dilemme : empathie ou responsabilité (la peur de “reconnaître une faute”)
L’empathie est un impératif moral et relationnel. Dans une crise, les publics attendent une organisation qu’elle se comporte comme un acteur humain : qu’elle comprenne la souffrance, qu’elle prenne au sérieux la peur, qu’elle reconnaisse l’impact. Mais beaucoup d’organisations hésitent : exprimer des regrets, n’est-ce pas admettre une culpabilité ? Dire “nous sommes désolés”, n’est-ce pas se “mettre en tort” ?
Ce dilemme est amplifié par le dialogue permanent entre communication et juridique. Le juriste pense en termes de risque de condamnation ; le communicant pense en termes de confiance. Les deux ont raison, mais à des horizons différents. Une crise mal gérée peut coûter autant (ou plus) qu’un contentieux, par la perte de légitimité, la fuite des talents, la défiance durable.
La clé est de distinguer plusieurs niveaux de langage :
- Empathie : reconnaître le préjudice, la peine, l’inquiétude (“Nous comprenons la gravité de ce que vivent les personnes concernées”).
- Responsabilité d’action : s’engager sur la prise en charge, la réparation, la prévention (“Nous mettons en place…”, “Nous coopérons…”).
- Responsabilité causale (qui a fait quoi) : attribuer les causes, souvent trop tôt au début.
- Responsabilité juridique : admettre une faute au sens légal.
On peut être profondément empathique et très engagé dans l’action sans trancher immédiatement la question juridique. Le public attend d’abord une posture : respect, considération, présence, capacité d’agir.
Quatrième dilemme : contrôler le récit ou accepter la polyphonie
En crise, l’organisation voudrait souvent “reprendre la main” sur le récit. C’est compréhensible : le récit conditionne la perception, et la perception influence les comportements (clients, partenaires, autorités). Mais la réalité contemporaine est celle d’un écosystème où la parole est distribuée :
- témoins et employés publient des vidéos ;
- experts commentent en direct ;
- militants structurent des campagnes ;
- médias traditionnels et réseaux se nourrissent mutuellement ;
- la satire, les mèmes et la culture numérique réinterprètent l’événement.
Le dilemme devient alors : faut-il chercher à imposer un récit unique ou dialoguer avec une pluralité de récits ? Trop de contrôle peut sembler manipulateur. Trop de dispersion peut donner une impression d’impuissance.
Le bon arbitrage repose souvent sur une idée simple : on ne contrôle pas le débat, on contrôle sa propre cohérence. L’organisation doit être stable sur ses fondamentaux : ce qu’elle reconnaît, ce qu’elle fait, ce qu’elle refuse, les valeurs qu’elle invoque, les preuves qu’elle apporte. Elle doit aussi accepter que certains récits ne seront pas “corrigés” par un communiqué : ils relèvent de la méfiance, de l’histoire antérieure, ou d’un conflit de valeurs. La communication de crise n’est pas une démonstration mathématique : c’est une interaction sociale.
Cinquième dilemme : parler d’une seule voix ou refléter la complexité interne
On enseigne souvent : “Une seule voix, un seul message.” Ce principe protège contre les contradictions publiques. Mais il peut devenir un piège : l’organisation est un corps collectif, composé de métiers, de sites, de filiales, d’équipes. Dans une crise, les réalités internes sont diverses. L’injonction à l’uniformité peut produire :
- des messages trop génériques et déconnectés du terrain ;
- une frustration des équipes qui “savent” et se sentent muselées ;
- une fuite d’informations non maîtrisée, car les salariés parlent autrement.
Le dilemme : centraliser pour être cohérent ou décentraliser pour être crédible localement. La solution passe par une architecture de parole :
- un cadre central (faits validés, principes, engagements, lignes rouges) ;
- des porte-parole adaptés selon les publics (technique, RH, direction, terrain) ;
- une discipline de mise à jour (versions, validation rapide, Q&A).
La cohérence n’implique pas la monotonie. Une crise se gère mieux quand la parole “tient” du siège au terrain, sans dissonance.
Sixième dilemme : protéger l’interne ou rassurer l’externe
Les organisations pensent souvent d’abord à l’externe : médias, clients, autorités, opinion. Pourtant, l’interne est un public décisif. Les salariés vivent la crise avec intensité : peur pour leur emploi, honte, colère, sentiment d’injustice, inquiétude morale. S’ils ne reçoivent pas d’informations fiables, ils deviennent vulnérables aux rumeurs et peuvent se transformer, malgré eux, en amplificateurs de confusion.
Le dilemme est classique : si l’on dit trop à l’interne, cela risque de fuiter ; si l’on ne dit rien, l’interne se fracture. La plupart des crises démontrent que le secret est rarement tenable : mieux vaut anticiper la fuite que la subir.
Une communication interne efficace n’est pas un “copier-coller” du communiqué. Elle doit répondre à des questions spécifiques : “Que dois-je dire si on m’interroge ?”, “Mon poste est-il menacé ?”, “Sommes-nous en sécurité ?”, “Quelle est la ligne de conduite ?”, “Qui est le point de contact ?”. En crise, l’interne est à la fois un public et un acteur. Le traiter uniquement comme un risque, c’est perdre un soutien précieux.
Septième dilemme : rassurer ou inquiéter (l’équilibre du risque)
Dans les crises sanitaires, industrielles, environnementales ou cyber, l’organisation doit parler du risque. Or parler du risque peut créer de l’angoisse, mais ne pas en parler peut être perçu comme une dissimulation. Les publics évaluent moins la “dangerosité objective” que la manière dont on les traite : respect, clarté, capacité à protéger.
Le dilemme : rassurer pour éviter la panique ou alerter pour prévenir. Les deux sont nécessaires, mais à condition de distinguer :
- la gravité (impact potentiel) ;
- la probabilité (chance que cela arrive) ;
- les mesures de mitigation (ce qui réduit le risque) ;
- les gestes attendus du public (quoi faire, quoi éviter).
Une bonne communication du risque est concrète, compréhensible, et orientée vers l’action. Les messages vagues (“tout est sous contrôle”) sont contre-productifs : ils déclenchent la suspicion, surtout si des images ou témoignages contredisent cette affirmation.
Huitième dilemme : la preuve ou la narration (données vs histoire)
Certains communicants misent tout sur les faits : chiffres, rapports, audits, infographies. D’autres misent sur la narration : visages, témoignages, récit de mobilisation. En réalité, le public attend les deux. En crise, la donnée sans récit paraît froide et technocratique ; le récit sans preuve paraît manipulateur.
Le dilemme : prouver ou raconter. La solution est une articulation : des preuves accessibles (documents, chronologies, indicateurs, sources) et un récit qui donne du sens (ce qui s’est passé, pourquoi on agit, ce qui change). Il faut aussi accepter un point souvent oublié : la preuve est parfois longue à produire (audit indépendant, enquête). Pendant ce temps, l’organisation doit maintenir une parole responsable sans se réfugier dans l’attente.
Neuvième dilemme : attaquer la critique ou reconnaître la part de vérité
Dans une crise, l’organisation peut se sentir injustement attaquée. Parfois, elle l’est. Mais répondre en mode combat (“contre-attaque”) est risqué : cela alimente la polarisation, transforme la crise en affrontement identitaire, et peut donner l’impression que l’organisation protège son image plutôt que les personnes affectées.
Le dilemme : se défendre ou se remettre en question. Un principe de prudence : en crise, la posture d’humilité est souvent plus efficace que la posture de confrontation, sauf cas de diffamation manifeste ou de manipulation avérée. Même dans ce dernier cas, la réponse doit rester proportionnée : démentir avec des faits, éviter l’insulte, ne pas “punir” la critique légitime.
Reconnaître une part de vérité (“nous aurions dû…”, “nous n’avons pas été à la hauteur sur…”) peut désamorcer. Mais cette reconnaissance doit être suivie d’actes. Sans action, l’aveu devient un symptôme de faiblesse.
Dixième dilemme : l’excuse publique ou la réparation silencieuse
Certaines cultures organisationnelles privilégient l’action : “réglons le problème, puis on communiquera.” D’autres privilégient le symbole : “présentons des excuses.” Or l’opinion ne se satisfait ni de l’un ni de l’autre isolément.
Le dilemme : excuses ou réparation. Dans l’idéal, l’excuse est un acte de reconnaissance et la réparation un acte de justice. Mais un danger existe : l’excuse peut devenir une performance, un rituel superficiel. À l’inverse, la réparation silencieuse peut être vécue comme une stratégie pour éviter la responsabilité.
Une sortie exigeante du dilemme : faire correspondre les niveaux. Si la crise a un impact humain fort, la parole doit être à la hauteur (respect, excuses si appropriées), et l’action doit être tangible (indemnisation, accompagnement, prévention). Si l’organisation ne peut pas détailler tout de suite la réparation, elle peut au moins annoncer des principes : “priorité aux victimes”, “expertise indépendante”, “mise à jour régulière”.
Onzième dilemme : la communication comme bouclier ou comme outil de gouvernance
Une dérive fréquente consiste à traiter la communication de crise comme un dispositif de protection de l’image, détaché de l’action. Dans ce cas, la communication devient un “bouclier” : minimisation, euphémisation, éléments de langage, gestion de perception. À court terme, cela peut limiter l’incendie médiatique. À moyen terme, c’est dévastateur : la crise se transforme en crise de confiance.
Le dilemme : protéger la réputation ou gouverner la crise. Le communicant de crise mature comprend que la meilleure communication est souvent une conséquence d’une bonne gouvernance : décisions rapides, responsabilités claires, actions vérifiables, coopération avec les autorités, mise en place d’instances indépendantes si nécessaire. Dans les crises majeures, la communication n’est pas un habillage : c’est une fonction de coordination, qui oblige l’organisation à se regarder en face.
Douzième dilemme : l’éthique de la persuasion (influencer sans manipuler)
Toute communication vise à influencer : apaiser, expliquer, convaincre, obtenir du temps, éviter la panique, maintenir la confiance. Mais où s’arrête l’influence légitime et où commence la manipulation ? En crise, la tentation est forte de jouer sur les émotions, de sélectionner les faits, d’utiliser des “effets de cadrage” pour orienter l’interprétation.
Le dilemme : persuader ou manipuler. Une boussole simple : la persuasion devient manipulation quand elle prive le public des éléments nécessaires pour décider librement (cacher un risque, travestir une responsabilité, instrumentaliser une victime, fabriquer une fausse controverse). La manipulation peut “marcher” un temps, mais elle laisse une trace. Et dans un monde de captation permanente, les manœuvres finissent souvent par être exposées, transformant une crise initiale en crise morale.
Treizième dilemme : le leadership incarné ou la prudence institutionnelle
Faut-il que le dirigeant prenne la parole ? Souvent oui, car certaines crises touchent à la confiance fondamentale et à la légitimité. L’incarnation humanise, montre que la crise est prise au sérieux, et engage l’autorité. Mais elle comporte des risques : une phrase maladroite, une posture jugée arrogante, un manque d’empathie visible, ou un engagement impossible à tenir. De plus, une parole trop centrée sur le leader peut apparaître comme narcissique.
Le dilemme : incarner ou institutionnaliser. Un bon compromis consiste à faire intervenir le leader sur les sujets de valeurs et d’engagement (priorités, responsabilité d’action, décisions structurantes), et à confier les détails techniques à des experts crédibles. L’incarnation n’est pas un show : c’est un acte de responsabilité.
Quatorzième dilemme : gérer la crise immédiate ou préparer l’après-crise
En crise, l’énergie est aspirée par le court terme : répondre aux journalistes, publier des mises à jour, gérer les demandes, calmer les réseaux. Pourtant, l’après-crise se fabrique pendant la crise. Les décisions prises sous pression deviennent des preuves de culture : transparence réelle ou cosmétique, respect des personnes ou réflexe de défense, capacité d’apprentissage ou déni.
Le dilemme : survivre aujourd’hui ou reconstruire demain. Concrètement, cela suppose de documenter, d’évaluer, de préparer des dispositifs de réparation, et surtout d’installer une logique d’amélioration. Une organisation qui sort bien d’une crise n’est pas celle qui “n’a rien perdu”, mais celle qui démontre qu’elle a compris, corrigé, et changé.
Quelques principes pour naviguer entre ces dilemmes
Les dilemmes ne disparaissent pas. Mais on peut les traverser avec méthode. Voici des principes de gouvernance de la parole, que j’enseigne souvent comme des “garde-fous” :
- Unité de réalité : ne jamais construire un message qui contredit ce que vivent les personnes sur le terrain. La vérité finit par remonter.
- Priorité humaine : avant l’image, avant la marque, il y a l’impact sur les personnes (victimes, clients, salariés).
- Méthode explicite : dire ce que l’on sait, ce que l’on ignore, ce que l’on fait, et quand on en saura plus.
- Preuves progressives : publier des éléments au fur et à mesure de leur validation ; annoncer des audits indépendants si nécessaire.
- Cohérence multi-canaux : le communiqué, la conférence, les réseaux, l’interne doivent raconter la même histoire, adaptée aux formats.
- Écoute active : analyser les préoccupations réelles (peur, colère, injustice), pas seulement les “mentions” ou la tonalité.
- Humilité et fermeté : humilité sur les zones d’incertitude, fermeté sur la protection des personnes et sur les engagements.
- Apprentissage : intégrer dès le début une logique de retour d’expérience et de transformation.
Ces principes ne garantissent pas l’absence de critique. Ils garantissent quelque chose de plus important : la capacité à rester crédible et à agir de façon responsable.
Le dilemme comme révélateur de culture
La communication de crise est une discipline de paradoxes. Elle exige simultanément rapidité et prudence, transparence et protection, empathie et rigueur, incarnation et maîtrise, écoute et leadership. Ceux qui cherchent des recettes simples se trompent de métier. La crise ne se “gère” pas seulement avec des mots ; elle se traverse avec des décisions, une éthique, et une cohérence entre ce que l’on dit et ce que l’on fait.
Au fond, le dilemme n’est pas un obstacle : c’est un révélateur. Il révèle la culture de l’organisation, sa relation à la vérité, son rapport aux personnes, sa capacité à reconnaître ses limites. Et c’est pour cela que la communication de crise est un domaine si exigeant : elle n’est pas une technique de persuasion, mais une épreuve de responsabilité. Lorsque l’organisation comprend cela, elle ne communique plus “pour sauver son image”. Elle communique pour protéger, expliquer, réparer, et reconstruire la confiance — qui est, en dernière analyse, le capital le plus difficile à regagner.