- Le dirigeant comme point de convergence : pourquoi sa parole pèse plus lourd que prévu
- Quand le dirigeant doit parler : l’art du “timing” sans improvisation
- Ce que le dirigeant doit apporter que personne d’autre ne peut apporter
- Comment le dirigeant doit parler : une grammaire de crise, pas un discours
- Les erreurs de dirigeant qui aggravent presque toujours une crise
- Le rôle interne du dirigeant : aligner, protéger, décider, tenir
- La continuité : la crise ne se termine pas quand on n’en parle plus
- Le dirigeant n’est pas là pour être aimé, il est là pour rendre la situation gouvernable
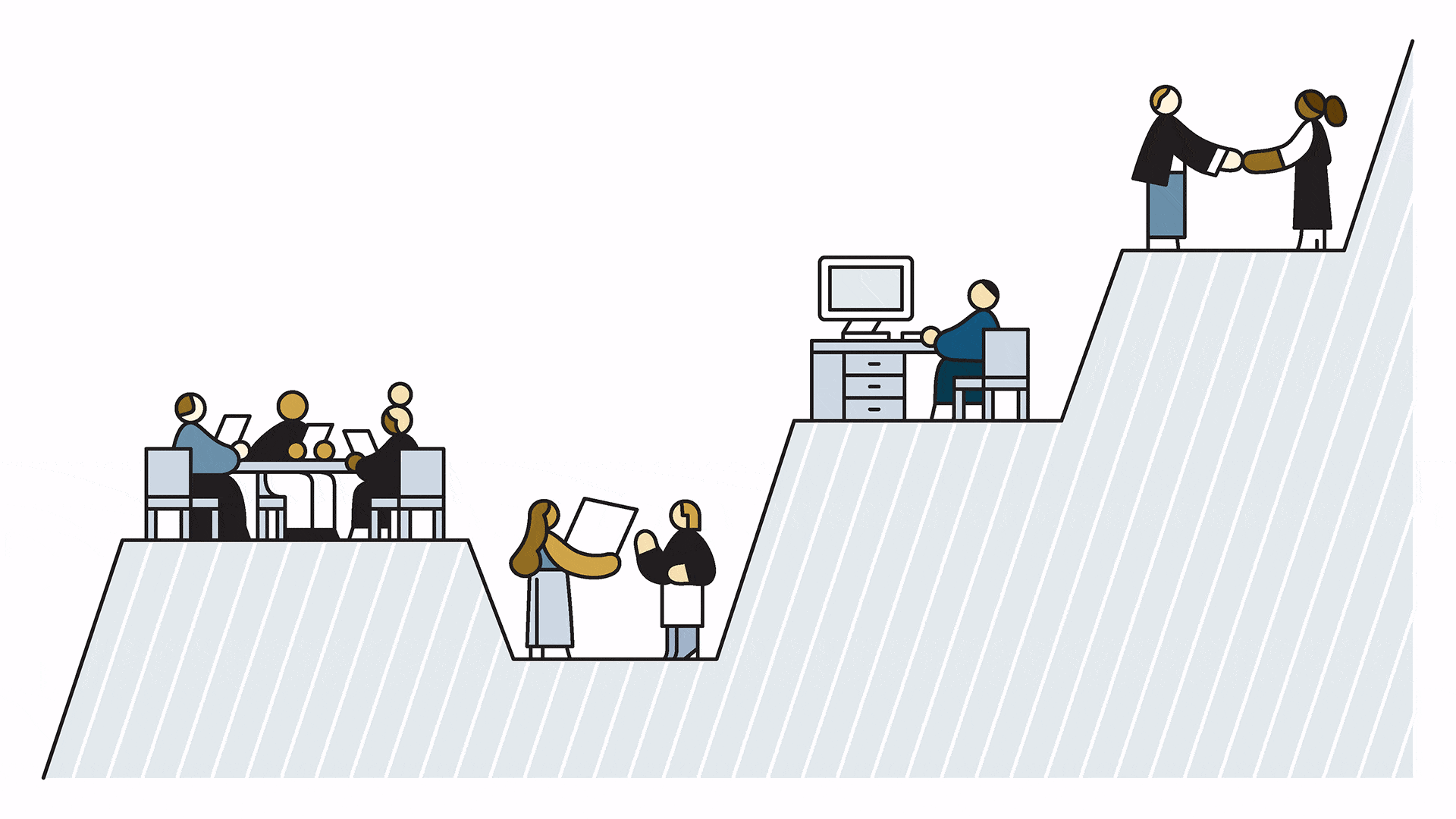
Dans une crise, le dirigeant n’est jamais seulement un décideur. Il devient un symbole. Et c’est précisément là que se loge sa “case aveugle” la plus dangereuse : croire que la crise est un événement à gérer, quand l’extérieur la vit comme un test d’identité. L’organisation est jugée sur ce qu’elle fait, certes, mais aussi sur ce qu’elle “est” dans l’épreuve. Et, dans l’esprit du public, cette identité se condense souvent dans une personne : celle qui incarne la responsabilité ultime analyse l’expert en communication de crise Florian Silnicki, Président Fondateur de l’agence LaFrenchCom.
Le paradoxe est cruel. Beaucoup de leaders ont été formés à la maîtrise, à l’anticipation, au contrôle. Or la crise impose l’inverse : accepter l’incertitude, exposer une part de fragilité, reconnaître l’impact avant de défendre la marque, tenir un cap moral tout en pilotant un dossier techniquement instable. Ce décalage produit des réflexes de protection qui, sans intention malveillante, aggravent la situation : se taire trop longtemps, parler trop tôt avec une certitude non prouvable, se réfugier dans le juridique, attaquer les critiques, promettre trop, chercher un coupable, ou au contraire vouloir “tout porter” et hyper-personnaliser la crise. Dans tous ces cas, la parole du dirigeant devient un accélérateur, parce qu’elle ne s’attaque pas au vrai besoin du moment : la confiance.
Comprendre le rôle du dirigeant en crise, c’est accepter une idée très simple mais structurante : le dirigeant ne “prend pas la parole”, il “prend la responsabilité du cadre”. Il ne s’agit pas de parler pour occuper l’espace. Il s’agit de rendre la situation gouvernable, pour l’extérieur comme pour l’intérieur, en articulant une posture, des décisions, un rythme et des preuves.
Le dirigeant comme point de convergence : pourquoi sa parole pèse plus lourd que prévu
En crise, le public ne distingue pas toujours la complexité de l’organisation. Il cherche une figure de cohérence. Les médias cherchent un interlocuteur qui engage. Les autorités cherchent un responsable identifiable. Les salariés cherchent un repère. Les clients cherchent quelqu’un qui “assume”. C’est une logique de simplification, presque anthropologique : face à l’incertitude, on veut un centre.
C’est là que naît la case aveugle du leader. Parce que, de l’intérieur, la crise est souvent vécue comme une multitude de tâches : investiguer, sécuriser, coordonner, décider, rédiger, répondre, réparer. De l’extérieur, elle est vécue comme une question beaucoup plus courte : “Est-ce qu’ils sont dignes de confiance, oui ou non ?” Et le dirigeant est supposé incarner la réponse.
Le problème, c’est que cette attente est parfois injuste. Le dirigeant ne peut pas tout savoir immédiatement, ni tout maîtriser. Pourtant, s’il se cache derrière cette impossibilité, il alimente l’hypothèse la plus défavorable : “ils fuient” ou “ils calculent”. Et s’il parle comme s’il savait tout, il s’expose au retournement le plus destructeur : la contradiction publique, qui se traduit instantanément en accusation de mensonge.
Son rôle est donc d’occuper une position étroite mais puissante : être présent sans surjouer, être clair sans être prématurément définitif, être humain sans être théâtral, être responsable sans se condamner inutilement, être ferme sans être arrogant.
Quand le dirigeant doit parler : l’art du “timing” sans improvisation
La question “faut-il que le dirigeant parle ?” est souvent mal posée. Dans la plupart des crises, la vraie question est : “à quel moment la présence du dirigeant augmente-t-elle la crédibilité plutôt que le risque ?”
Il existe des crises où le dirigeant doit parler très tôt, parce que l’enjeu dépasse le technique. C’est le cas lorsque des vies sont touchées, lorsque la sécurité est mise en cause, lorsque l’incident met en jeu les valeurs et l’éthique, lorsque la confiance est déjà brisée, lorsque l’organisation est soupçonnée de dissimulation, ou lorsque l’organisation est structurellement responsable même si un tiers opère sur le terrain. Dans ces configurations, la délégation peut être perçue comme une fuite. L’absence du dirigeant devient une forme de message : “ce n’est pas notre sujet”, “ce n’est pas si grave”, “je ne veux pas être associé”. L’extérieur ne lit pas la subtilité ; il lit la hiérarchie des priorités.
Il existe aussi des crises où une parole trop rapide du dirigeant peut être contre-productive, par exemple lorsque les faits sont extrêmement incertains, lorsque l’enquête est en cours et fragile, lorsque les obligations de procédure imposent une prudence sur certains éléments, ou lorsque la présence du dirigeant polarise trop et transforme une situation technique en combat symbolique. Dans ces cas, il peut être plus efficace de laisser un porte-parole opérationnel ou expert s’exprimer d’abord, à condition que le dirigeant soit visible autrement : en pilotage interne, en coordination avec les autorités, en soutien aux victimes, et en engagement public à rendre compte.
Mais la règle la plus robuste n’est pas “parler tôt” ou “parler tard”. La règle robuste est : ne jamais laisser l’organisation sans figure de responsabilité au moment où le public a déjà identifié une crise. Si le dirigeant ne parle pas immédiatement, il doit s’assurer que le dispositif de parole est solide, et qu’il existe un rendez-vous explicite où sa présence sera attendue. Cela empêche la crise de se structurer autour d’une absence.
La temporalité aide. Dans la première heure, un dirigeant peut ne pas être celui qui détaille. Il peut être celui qui reconnaît, priorise et annonce la méthode. Dans les vingt-quatre heures, il peut consolider la posture et l’engagement. Dans la semaine, il doit tenir les rendez-vous, soutenir et prouver. Dans le mois, il doit rendre compte et porter les transformations. Ce n’est pas la même parole, et c’est une erreur classique de répéter le même discours à chaque séquence.
Ce que le dirigeant doit apporter que personne d’autre ne peut apporter
Un dirigeant en crise n’est pas utile parce qu’il “communique”. Il est utile parce qu’il apporte trois choses spécifiques.
La première est l’autorité d’engagement. Un responsable communication peut expliquer, un expert peut éclairer, un directeur opérationnel peut détailler les mesures, mais seul le dirigeant peut engager l’organisation sur une priorité, une allocation de ressources, une décision difficile, une transformation structurelle. Quand le dirigeant parle, l’extérieur veut entendre : “voici ce que nous faisons, et voici ce que nous sommes prêts à changer, même si cela coûte”.
La deuxième est la cohérence morale. Beaucoup de crises sont jugées sur un axe éthique : respect, justice, sécurité, transparence, dignité. Le dirigeant doit rendre explicite ce qui est non négociable et ce qui est attendu en interne. Ce n’est pas un discours de valeurs abstraites ; c’est une traduction opérationnelle : “voici les décisions que ces valeurs imposent, maintenant”. Sans cela, les valeurs deviennent du marketing, et le marketing, en crise, ressemble à du cynisme.
La troisième est la protection. Le dirigeant doit protéger ceux qui sont exposés : victimes, publics concernés, équipes front, salariés en première ligne. Cette protection est concrète. Elle passe par des dispositifs, des moyens, des consignes, une tolérance zéro pour les violences, une clarté sur les priorités. Quand un dirigeant donne l’impression que l’organisation protège d’abord sa réputation, il perd la bataille. Quand il donne l’impression qu’il protège d’abord les personnes et la vérité du moment, il regagne de l’espace.
Comment le dirigeant doit parler : une grammaire de crise, pas un discours
La parole de crise la plus efficace n’est pas longue. Elle est structurée. Elle répond à l’ordre psychologique de l’audience, pas à l’ordre administratif de l’organisation.
Le dirigeant doit commencer par reconnaître l’impact et la gravité, parce que c’est le point d’entrée émotionnel. Cela ne signifie pas surjouer, ni s’effondrer, ni faire de la compassion un spectacle. Cela signifie nommer le vécu : inquiétude, colère, peur, perturbation, souffrance. Tant que cet impact n’est pas reconnu, tout le reste sonne comme une défense.
Ensuite, il doit dire ce qui est fait immédiatement. Une crise se calme rarement par des adjectifs ; elle se calme par des actions. Le dirigeant n’a pas besoin de tout expliquer, mais il doit pouvoir dire : “nous avons décidé ceci”, “nous avons mis en place cela”, “nous avons stoppé / sécurisé / rappelé / suspendu”, “nous avons ouvert un dispositif d’aide”. S’il ne peut pas citer une action, la parole devient une promesse abstraite, et une promesse abstraite est fragilisante.
Après cela, il doit clarifier la vérité du moment : ce qui est confirmé et ce qui ne l’est pas. Un dirigeant crédible n’est pas celui qui “sait tout”, c’est celui qui sait distinguer le certain de l’incertain et expliquer comment l’incertain sera résolu. Ce point est essentiel, car il protège contre la contradiction future. Dire “nous ne savons pas encore” n’est pas une faiblesse si l’on ajoute “voici notre méthode, voici nos partenaires, voici notre calendrier de mise à jour”.
Enfin, il doit annoncer un rythme et une forme de redevabilité : un point d’étape à une heure donnée, un audit, une enquête, une publication, une transparence graduée, un bilan. C’est là que se joue la différence entre un discours et un engagement. Le dirigeant doit sortir de la phrase performative (“nous prenons au sérieux”) et entrer dans la phrase traçable (“nous publierons une mise à jour à telle date, et un rapport à telle date”).
Dans cette grammaire, le “je” doit être utilisé avec prudence. Trop de “je” transforme la crise en drame personnel. Trop de “nous” impersonnel transforme la crise en machine froide. Le bon équilibre est souvent celui-ci : le dirigeant prend la responsabilité dans le “je” au moment des engagements clés, puis revient au “nous” pour montrer l’organisation en action. Le public ne veut pas un héros ; il veut une organisation gouvernable.
Les erreurs de dirigeant qui aggravent presque toujours une crise
La première erreur est la promesse absolue. “Ça ne se reproduira jamais”, “il n’y a aucun risque”, “tout est sous contrôle” sont des phrases tentantes parce qu’elles donnent une impression d’autorité. Elles sont aussi des pièges, parce que la crise est précisément un moment où l’on ne contrôle pas tout. Si un seul élément contredit la promesse, le dirigeant ne sera plus jugé sur l’incident, mais sur le mensonge. La prudence intelligente consiste à promettre ce qui est tenable : des actions, des délais, des preuves, des mises à jour. On peut dire “nous mettons en place des mesures pour réduire le risque” plutôt que “il n’y aura plus de risque”. On peut dire “nous rendrons compte” plutôt que “faites-nous confiance”.
La deuxième erreur est la guerre contre l’extérieur. Attaquer les médias, ridiculiser les critiques, dénoncer “l’acharnement”, se poser en victime est une posture presque toujours catastrophique. Elle décentre l’attention des personnes touchées vers l’ego de l’organisation. Elle galvanise l’adversité. Elle transforme une crise gérable en conflit identitaire. Un dirigeant peut corriger des informations fausses, mais il doit le faire avec calme, preuves, et sobriété, sans posture émotionnelle de plainte.
La troisième erreur est le juridisme comme unique langage. Le dirigeant a le droit d’être prudent, mais il n’a pas le droit d’être inhumain. Un langage exclusivement procédural peut être perçu comme une tentative de se couvrir. Il faut apprendre à distinguer culpabilité légale et responsabilité morale. On peut exprimer des regrets, reconnaître l’impact, et prendre des mesures de protection sans conclure juridiquement sur la faute. Quand le dirigeant refuse même l’empathie minimale, il signe souvent une crise de confiance plus large que l’événement initial.
La quatrième erreur est la dissonance entre le ton et les actes. Une déclaration grave accompagnée d’actions minimales paraît hypocrite. À l’inverse, des actions fortes accompagnées d’un ton léger paraissent indécentes. En crise, la forme n’est pas un emballage ; elle est un message. Le dirigeant doit être attentif à des détails qui semblent secondaires en interne mais qui deviennent symboliques dehors : décor, mise en scène, tenue, sourire, langage, priorités affichées, timing. Ce n’est pas du théâtre ; c’est la perception de l’alignement.
La cinquième erreur est l’hyper-personnalisation. Le dirigeant qui veut tout porter, tout répondre, tout incarner, court deux risques : l’épuisement et la polarisation. Sur les réseaux, une crise centrée sur une personne devient un duel, et le duel nourrit la violence symbolique. Le dirigeant doit incarner la responsabilité, mais il doit aussi montrer l’organisation : experts, opérations, dispositifs, gouvernance. Ce n’est pas “moi contre la crise”, c’est “nous, en action, avec une méthode”. Une crise n’a pas besoin d’un personnage principal ; elle a besoin d’une structure.
Le rôle interne du dirigeant : aligner, protéger, décider, tenir
On parle beaucoup de la parole externe du dirigeant. On oublie que sa fonction la plus décisive, souvent, est interne. Une crise révèle les fractures internes : silos, rivalités, lenteurs de validation, peur de la faute, culture du secret, fatigue. Sans pilotage, ces fractures deviennent visibles dehors. Le dirigeant doit donc imposer une discipline de gouvernance : qui décide, sur quoi, dans quel délai ; quelles priorités sont non négociables ; quelle vérité du moment est partagée ; quel rythme interne est tenu.
Il doit aussi protéger les équipes exposées. Cela signifie donner des moyens au service client, au terrain, aux community managers, aux managers de proximité. Cela signifie autoriser des mesures de protection face à l’agressivité. Cela signifie reconnaître la fatigue, et ne pas faire porter à la base le coût émotionnel de la crise pendant que le sommet se protège. Un dirigeant qui laisse ses équipes front “prendre” la colère sans soutien se construit un ennemi interne, et cet ennemi interne finit par parler, ou par se désengager. Les deux nuisent à la gestion.
Le dirigeant doit enfin tenir la cohérence entre ce qui est dit et ce qui est fait. En crise, les promesses deviennent des dettes publiques. Le dirigeant est garant du paiement de ces dettes : points d’étape, audits, réparations, décisions, réformes. Il ne peut pas déléguer la responsabilité de tenir. Il peut déléguer la production, jamais l’engagement.
La continuité : la crise ne se termine pas quand on n’en parle plus
Une des plus grandes cases aveugles du leader est de croire que la crise se termine quand le bruit baisse. Le bruit baisse parfois parce que l’attention médiatique se déplace, pas parce que la confiance est revenue. Et si le dirigeant confond baisse de bruit et résolution, il commet l’erreur la plus coûteuse : disparaître avant d’avoir rendu compte. Dans cette disparition se loge le soupçon durable : “ils ont fait le minimum pour calmer, puis ils ont repris comme avant”.
Le dirigeant doit donc penser la crise comme une trajectoire de redevabilité. Dans les premières heures, il reconnaît et protège. Dans les premiers jours, il prouve et soutient. Dans les semaines, il répare et transforme. Et il rend compte publiquement de ce qu’il a appris. Ce retour d’expérience, souvent redouté, est l’un des gestes les plus puissants. Il n’a pas besoin d’être auto-accusateur. Il doit être substantiel : chronologie stabilisée, causes confirmées, décisions prises, mesures en cours, mécanismes de contrôle, calendrier de suivi. Il doit surtout éviter l’auto-justification. Une crise se termine mieux avec un bilan humble qu’avec une autosatisfaction.
Le dirigeant n’est pas là pour être aimé, il est là pour rendre la situation gouvernable
Le rôle du dirigeant en crise n’est pas de gagner un concours de communication. Il est de garantir la gouvernance du réel sous pression. Sa parole n’est crédible que si elle s’adosse à des actions et à des preuves. Sa présence n’est utile que si elle apporte une autorité d’engagement, une cohérence morale et une protection des personnes. Sa prudence n’est respectable que si elle n’est pas un prétexte au silence. Son empathie n’est acceptable que si elle n’est pas un décor.
La “case aveugle” du leader, c’est de croire que la crise est un problème à résoudre et un récit à contrôler. La crise est d’abord une relation à réparer et une confiance à reconstruire. Et cette reconstruction n’exige pas un dirigeant parfait. Elle exige un dirigeant lucide : capable de dire vrai au présent, de décider vite sans surpromettre, de tenir des rendez-vous, de protéger les personnes, et de rendre compte jusqu’au bout.
Quand un dirigeant réussit cela, il ne “sauve pas l’image”. Il restaure quelque chose de plus précieux : la preuve, rare en temps de crise, qu’une organisation peut rester humaine et gouvernable quand tout tremble.