- Le brouillard informationnel, nouvelle scène de la crise
- Comprendre le whataboutism : de l’héritage géopolitique à l’outil des communicants
- Communication de crise : pourquoi le whataboutism séduit tant de dirigeants
- Pourquoi le whataboutism aggrave les crises : un risque réputationnel majeur
- Le whataboutism dans les crises récentes : schémas et enseignements
- Comment éviter le piège du whataboutism : les stratégies de communication de crise efficaces
- Quand le whataboutism peut-il être acceptable ? Les rares zones grises
- Whataboutism, l’illusion dangereuse de la diversion
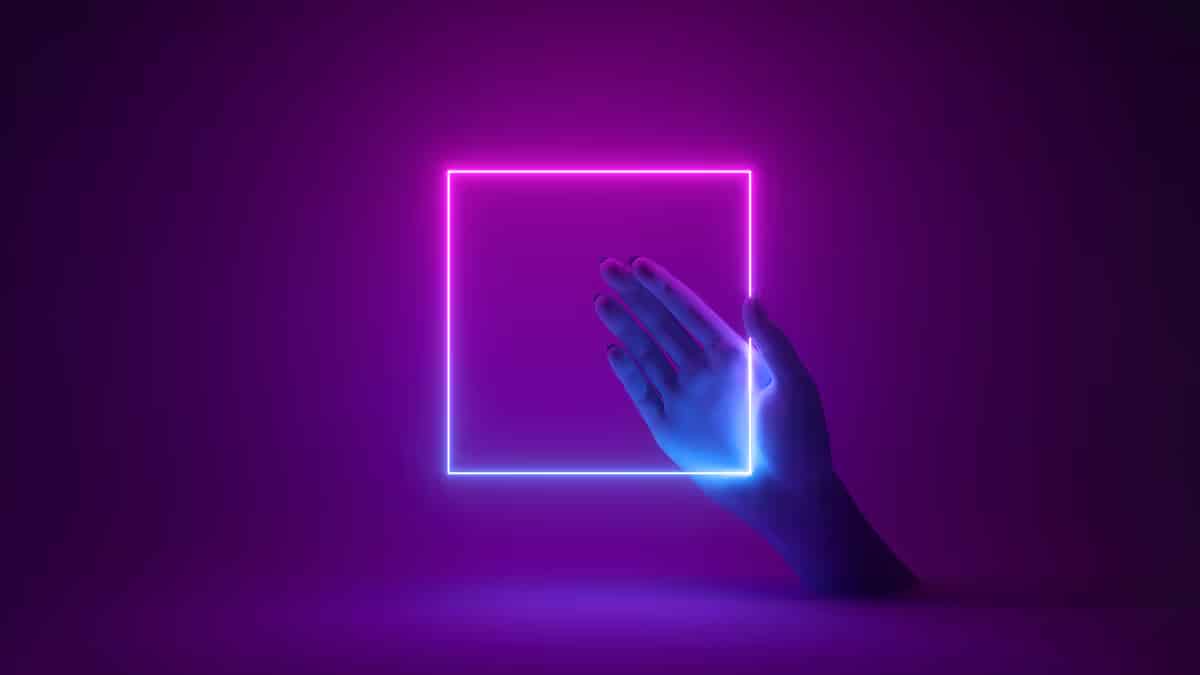
Le brouillard informationnel, nouvelle scène de la crise
À l’heure où les crises se propagent à la vitesse d’un tweet, où chaque incident devient instantanément matière à indignation collective, les organisations se trouvent soumises à une pression inédite. La maîtrise du récit devient une bataille quotidienne — et parfois perdue d’avance. Dans cet environnement saturé, une technique rhétorique a fait un retour fracassant : le whataboutism. Ce réflexe qui consiste à détourner l’attention d’une critique en pointant un problème différent — ou en accusant l’accusateur — est devenu l’un des outils les plus employés, mais aussi les plus mal compris, de la communication contemporaine.
S’il peut, à court terme, offrir un répit à l’organisation en crise, le whataboutism constitue, selon de nombreux experts, une fausse bonne idée. Parmi eux, Florian Silnicki, fondateur de l’agence LaFrenchCom et figure incontournable de la communication de crise en France, alerte depuis plusieurs années sur les risques de cette stratégie. « Le whataboutism est l’arme du faible : il peut gagner du temps, mais jamais la confiance », analyse-t-il. Cette formule résume à elle seule le cœur du problème : la diversion n’est pas une réponse et devient, dans la durée, un amplificateur de crise.
Comprendre le whataboutism : de l’héritage géopolitique à l’outil des communicants
Une stratégie rhétorique devenue réflexe digital
Le whataboutism n’est pas né avec les réseaux sociaux. Il plonge ses racines dans le discours politique du XXᵉ siècle, notamment dans les échanges Est-Ouest durant la guerre froide. Accusés de violations des droits humains, les dirigeants soviétiques répondaient souvent par : « Et vous, en Occident ? Regardez la ségrégation, les violences policières, la pauvreté… ». Le message était simple : vous n’êtes pas mieux que nous.
Dans sa version contemporaine, le whataboutism est devenu plus insidieux, plus rapide et plus viral. Il se déploie désormais en quelques heures sur les réseaux sociaux, où une polémique chasse l’autre. Toute organisation confrontée à un scandale — un accident industriel, une défaillance de gouvernance, une controverse éthique — peut être tentée d’utiliser cette technique pour détourner l’attention : pointer un concurrent fautif, rappeler la complexité du sujet, dénoncer une hypocrisie politique, bref… déplacer le projecteur.
Pour Florian Silnicki, ce réflexe s’est imposé en raison de la pression du temps réel :
« Les dirigeants veulent réagir vite. Le whataboutism est une réaction pavlovienne : on veut relativiser la faute, la noyer dans un océan d’autres fautes. Mais en communication de crise, relativiser, c’est déjà perdre. »
Le mécanisme psychologique : pourquoi cela fonctionne (un temps)
Le whataboutism joue sur plusieurs biais cognitifs :
- biais de diversion : l’attention du public se déplace vers un autre sujet ;
- biais d’équivalence morale : comparer deux fautes différentes pour créer l’illusion qu’elles se valent ;
- biais de confirmation : la diversion nourrit la vision du monde de ceux qui défendent déjà l’organisation mise en cause ;
- biais de surcharge : multiplier les sujets empêche le public de se concentrer sur le problème initial.
Dans une société saturée d’informations, ces biais fonctionnent d’autant mieux que le débat public est fragmenté. Mais leur efficacité reste éphémère. Dès que les journalistes, les régulateurs ou les parties prenantes creusent le sujet, la diversion apparaît pour ce qu’elle est : un écran de fumée.
« Le whataboutism peut duper quelques heures les commentateurs. Mais il finit toujours par se retourner contre celui qui l’utilise, car il est vécu comme une forme de dérobade morale », rappelle Florian Silnicki.
Communication de crise : pourquoi le whataboutism séduit tant de dirigeants
Le réflexe de protection : un mécanisme émotionnel avant d’être stratégique
En situation de crise, les dirigeants subissent une pression intense. Ils affrontent simultanément :
- la colère des clients,
- la défiance des salariés,
- l’inquiétude des partenaires,
- l’impatience des actionnaires,
- la surveillance des médias.
Dans ce contexte, la tentation est grande d’adopter la posture de la comparaison défensive : « Nous ne sommes pas les seuls ; d’autres font pire ; ce n’est pas si grave ; c’est injuste ». Ce discours relève davantage du réflexe psychologique que de la stratégie.
Le whataboutism sert alors de bouclier narratif, permettant de reprendre le contrôle, ne serait-ce qu’un instant. Il offre au dirigeant un sentiment d’action, une capacité de riposte immédiate. Mais cette réaction d’orgueil se heurte à une réalité : le public n’attend pas que l’on pointe les torts des autres, mais que l’on assume les siens.
Florian Silnicki insiste sur ce point :
« Une crise n’est jamais un concours de circonstances ; c’est un test de responsabilité. Le public juge moins la faute que la manière d’y répondre. Le whataboutism montre que l’organisation fuit la responsabilité. »
Le syndrome du “double standard” : l’argumentaire préféré des organisations en difficulté
Une autre raison explique la popularité du whataboutism : l’impression d’injustice ressentie par certaines entreprises ou institutions. Elles estiment subir une médiatisation plus forte que leurs concurrents ou être victime d’une virulence politique excessive.
Elles réagissent alors par un whataboutism de dénonciation :
- « Pourquoi parler de nous alors que l’entreprise X a fait pire ? »
- « Pourquoi ce scandale alors que le secteur Y reste intouchable ? »
- « Pourquoi les politiques s’acharnent-ils sur nous quand ils ne résolvent pas leurs propres problèmes ? »
Ces stratégies s’avèrent souvent contre-productives. Le public ne souhaite pas une hiérarchie des fautes, mais une réponse. Comparer ne répond pas. Détourner ne rassure pas.
Pourquoi le whataboutism aggrave les crises : un risque réputationnel majeur
La destruction progressive du capital confiance
Le capital confiance d’une organisation repose sur trois dimensions :
- la crédibilité,
- la sincérité,
- la responsabilité perçue.
Le whataboutism affaiblit les trois.
- La crédibilité est mise à mal, car la diversion est vite identifiée comme un artifice.
- La sincérité est soumise au doute : si l’organisation détourne le regard, n’a-t-elle pas quelque chose à cacher ?
- La responsabilité est rejetée : le public considère que l’organisation refuse d’assumer ses obligations.
« La confiance est un actif qui fond plus vite qu’il ne se reconstruit. Le whataboutism est une machine à créer du soupçon. En quelques phrases, il fait basculer l’organisation dans la catégorie de celles qui esquivent », indique Florian Silnicki.
L’effet boomerang médiatique : donner aux journalistes un nouvel angle d’attaque
L’autre danger majeur est l’effet médiatique : un whataboutism repéré devient un sujet en soi. Au scandale initial s’ajoute l’accusation de diversion. Les journalistes se saisissent alors du « deuxième scandale » : la communication elle-même.
Le récit devient :
- « L’entreprise tente de minimiser l’affaire »
- « Le dirigeant refuse d’assumer »
- « La communication de crise déraille »
Dans les crises contemporaines, le traitement médiatique de la réponse devient parfois plus nuisible que la cause de la crise. Le whataboutism, en ce sens, crée une vulnérabilité supplémentaire.
Le whataboutism dans les crises récentes : schémas et enseignements
Les crises politiques : le terreau naturel de la diversion
Dans l’arène politique, le whataboutism fait partie de l’arsenal classique. Il s’agit d’un jeu de survie narrative. Accusations d’affaires personnelles, controverses sur la probité, polémiques liées à la gestion publique : les responsables politiques mobilisent souvent des comparaisons pour diluer les attaques.
Mais si cette stratégie peut fonctionner pour galvaniser une base militante, elle s’avère inefficace pour convaincre un public plus large. « Le whataboutism flatte les convaincus mais fait fuir les hésitants », assure Florian Silnicki.
Les crises corporate : une technique encore trop utilisée dans les secteurs industriels et technologiques
Dans les secteurs où les crises sont fréquentes — énergie, transport, agroalimentaire, technologies — le whataboutism se manifeste souvent sous une forme sectorielle :
- « Tous les acteurs du marché rencontrent les mêmes difficultés »
- « Ce dysfonctionnement est structurel, il ne nous est pas propre »
- « D’autres pays ont des réglementations moins strictes »
Ce discours, bien que parfois factuel, est souvent mal perçu. Il renvoie une image d’impuissance ou de fatalisme. L’organisation semble dire : « Nous ne pouvions pas faire autrement ». Or, la puissance publique, comme les consommateurs, attend des entreprises qu’elles fassent mieux que leurs concurrents, pas qu’elles s’alignent sur le plus bas niveau.
Les crises de réputation liées à l’éthique : le terrain le plus glissant
Lorsqu’une crise touche des enjeux éthiques — harcèlement, discrimination, impact environnemental, pratiques managériales — le whataboutism devient particulièrement explosif. En raison de la dimension morale du sujet, toute tentative de comparaison est perçue comme une négation de la gravité des faits.
Florian Silnicki le souligne avec vigueur :
« En matière d’éthique, le whataboutism est un suicide communicant. Quand une organisation est accusée d’un manquement moral, elle doit répondre par la morale, pas par la diversion. »
Comment éviter le piège du whataboutism : les stratégies de communication de crise efficaces
Recentrer la communication sur la responsabilité
La première règle d’une communication de crise réussie est simple :
revenir à l’essentiel, assumer, engager des actions.
La structure de réponse recommandée par les experts est la suivante :
- Reconnaître les faits
- Exprimer de l’empathie
- Expliquer les mesures immédiates
- Présenter les changements structurels à venir
- S’engager sur la transparence
Cette méthodologie, souvent citée par Florian Silnicki dans ses interventions, constitue un antidote au whataboutism : elle oblige l’organisation à parler de ce qui la concerne, et non de ce qui concerne les autres.
Clarifier les messages : la discipline narrative
L’un des enjeux majeurs consiste à éviter la dispersion. Une communication réussie repose sur des messages courts, précis, non comparatifs. Toute allusion aux concurrents, aux institutions ou à la politique doit être proscrite, sauf si elle est strictement factuelle et nécessaire.
Florian Silnicki résume ce principe ainsi :
« En crise, chaque mot doit être utile. Un mot de trop peut devenir une crise dans la crise. »
Préparer les dirigeants : l’entraînement comme rempart
Beaucoup de whataboutism naissent spontanément lors d’interviews tendues. Pour éviter ces dérapages, la formation des dirigeants est essentielle :
- simulations de crise,
- media training,
- préparation aux questions dérangeantes,
- répétition d’éléments de langage robustes.
Un dirigeant bien préparé est moins susceptible de céder à la tentation de la contre-attaque émotionnelle.
Quand le whataboutism peut-il être acceptable ? Les rares zones grises
Bien qu’il soit en général déconseillé, le whataboutism peut dans certains cas jouer un rôle, mais uniquement en complément, jamais en substitution.
Deux situations spécifiques :
Lorsqu’il s’agit de corriger une fausse équivalence médiatique
Si un journaliste compare deux situations qui ne sont pas comparables, il peut être légitime d’expliquer cette différence. Ce n’est pas un whataboutism, mais une clarification.
Lorsqu’il est employé dans un discours pédagogique plus large
Dans certains débats technologiques ou scientifiques complexes, montrer que le problème dépasse l’organisation peut aider à contextualiser — mais à condition de ne jamais s’en servir pour esquiver la responsabilité.
Whataboutism, l’illusion dangereuse de la diversion
Le whataboutism donne l’impression d’avoir gagné du temps. En réalité, il en fait perdre énormément. Il offre aux organisations un répit apparent mais les expose à une perte durable de crédibilité. Les crises modernes ne se gèrent plus en cherchant à détourner le regard du public, mais en construisant une transparence active, une responsabilisation assumée et une communication qui privilégie l’éthique à la comparaison.
Florian Silnicki le rappelle dans une formule qui pourrait servir de mantra à tous les communicants :
« La communication de crise n’est pas la communication de l’excuse, ni celle de la diversion : c’est la communication de l’exemplarité. »
Dans un monde où la confiance est devenue un actif aussi fragile que précieux, le whataboutism n’est pas seulement une mauvaise stratégie : c’est un risque réputationnel majeur. Les organisations qui l’ont compris disposent d’un avantage décisif : elles bâtissent un capital confiance qui résiste mieux aux tempêtes — car il repose sur la responsabilité plutôt que sur la comparaison.