- Quand la justice s’en mêle, la communication change de nature
- Ce qu’il faut dire : la vérité utile, documentée, responsable
- Ce qu’il ne faut jamais dire
- Le triangle d’or : Droit – Fait – Légitimité
- Comment articuler juristes, communicants et dirigeants
- Le bon tempo : ni avant, ni après la justice
- Le message invisible : le respect de la justice
- En résumé
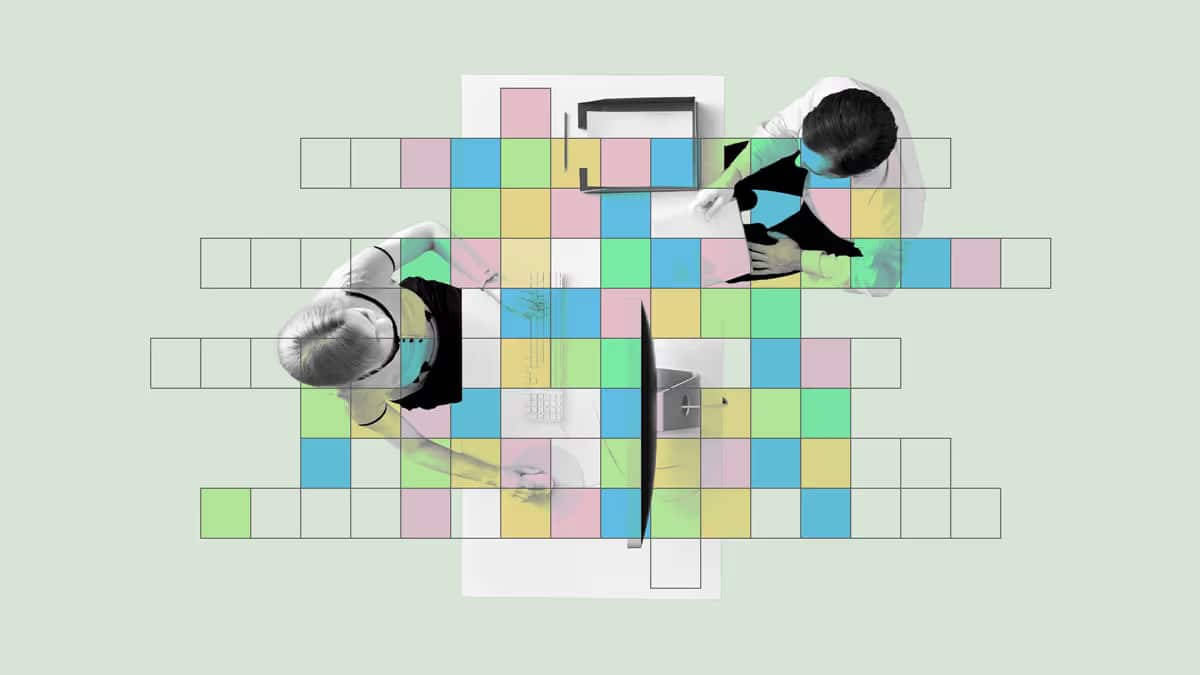
Quand une entreprise ou un dirigeant se retrouve confronté à la justice — enquête, mise en examen, procédure administrative ou procès —, la parole publique devient une arme à double tranchant.
Trop tôt, elle compromet la défense. Trop tard, elle laisse la rumeur installer la culpabilité. Trop vague, elle alimente la suspicion.
Trop arrogante, elle déclenche la défiance.
Dans ces moments, communiquer n’est pas “parler”, c’est protéger : protéger la vérité des faits, le respect de la justice, la réputation et la capacité d’agir.
Quand la justice s’en mêle, la communication change de nature
Dans une crise “classique”, l’objectif est de rétablir la confiance.
Dans une crise sous contrainte judiciaire, l’objectif est de ne pas aggraver le risque légal tout en préservant le capital réputationnel.
L’entreprise ne s’adresse plus seulement à l’opinion :
elle s’adresse aussi, indirectement, aux juges, aux enquêteurs, aux régulateurs, aux avocats, aux plaignants, et aux marchés.
Chaque mot peut avoir une valeur probatoire.
Chaque phrase peut être citée dans un rapport, une ordonnance ou un jugement.
Chaque silence peut être interprété comme une reconnaissance tacite.
C’est pourquoi la communication judiciaire est un exercice de funambule :
Trop d’émotion, on perd le contrôle.
Trop de droit, on perd l’humain.
Trop de stratégie, on perd la crédibilité.
Ce qu’il faut dire : la vérité utile, documentée, responsable
Les faits, rien que les faits
Une communication judiciaire efficace repose sur la discipline du factuel.
Pas d’hypothèses, pas de supposition, pas d’interprétation : uniquement ce qui est établi, vérifiable, traçable.
Exemple de posture juste :
« Nous avons pris connaissance de la procédure. Nous coopérons pleinement avec les autorités compétentes. Nous partageons toutes informations factuelles au fur et à mesure qu’elles sont établies. »
Cette sobriété protège. Elle donne le ton d’une entreprise maîtresse d’elle-même, respectueuse du droit et des faits.
La responsabilité, pas la culpabilité
Reconnaître une situation n’est pas reconnaître une faute.
La communication responsable ne nie pas les faits, mais assume la responsabilité de les gérer.
« Nous prenons la situation très au sérieux. Nous avons immédiatement lancé des vérifications internes et renforcé nos contrôles. »
Cette nuance est essentielle :
- elle manifeste le sens des responsabilités,
- sans compromettre la stratégie juridique.
L’empathie, mais sans émotion débridée
Dans toute affaire judiciaire, il y a des personnes affectées : salariés, clients, riverains, victimes, familles.
Les ignorer est une faute morale et stratégique.
Mais l’excès d’émotion expose au soupçon de calcul.
« Nos premières pensées vont aux personnes concernées. Notre priorité est de comprendre, de corriger et de réparer. »
L’empathie ne doit pas être un outil de défense, mais une expression sincère de responsabilité.
Ce qu’il ne faut jamais dire
Les dénégations absolues
« Nous n’avons rien à nous reprocher. »
« Cette affaire est une manipulation. »
« Tout cela est faux. »
Ces phrases enferment.
Elles empêchent toute évolution du discours si les faits changent.
Elles sont interprétées comme du mépris pour la justice et du déni de réalité.
La confiance se perd dès la première contradiction.
Les justifications techniques
« C’est un problème de procédure. »
« Il n’y a pas de base légale à cette enquête. »
Même si elles sont juridiquement exactes, ces phrases sonnent comme des arguties.
L’opinion veut comprendre le sens, pas le détail du Code de commerce.
Elles enferment la parole dans un langage défensif, perçu comme fuyant.
Les attaques contre les institutions
« Le régulateur nous en veut. »
« La justice fait de la politique. »
« Les médias manipulent l’opinion. »
Ces réflexes sont les plus destructeurs.
Ils isolent, crispent, déclenchent la défiance et ferment toute porte au dialogue institutionnel.
Aucune crise judiciaire ne se résout contre les institutions.
Elle se résout avec elles.
Les confidences “off”
L’erreur la plus fréquente : croire qu’un “off” avec un journaliste restera confidentiel.
En réalité, chaque mot prononcé peut resurgir, souvent sorti de son contexte.
Dans une procédure judiciaire, un off est une fuite potentielle.
La seule stratégie viable : ne jamais dire ce qu’on ne pourrait pas assumer publiquement.
Le triangle d’or : Droit – Fait – Légitimité
En communication judiciaire, chaque message doit cocher trois cases :
| Dimension | Objectif | Question à se poser |
|---|---|---|
| Droit | Ne pas compromettre la procédure | Ce que je dis est-il juridiquement sûr ? |
| Fait | Rester strictement dans la réalité vérifiée | Ai-je la preuve de ce que j’affirme ? |
| Légitimité | Donner du sens à la parole publique | Mon message contribue-t-il à restaurer la confiance ? |
Quand ces trois dimensions sont alignées, la communication devient sûre, claire et crédible.
Comment articuler juristes, communicants et dirigeants
Le risque principal d’une affaire judiciaire, c’est la disjonction des métiers :
- le juridique veut le silence,
- la communication veut la parole,
- le dirigeant veut rassurer.
L’art consiste à travailler ensemble, sous une même logique :
- Le juriste définit les bornes légales.
- Le communicant traduit ces bornes en messages compréhensibles et respectueux du droit.
- Le dirigeant incarne cette ligne avec clarté et sang-froid.
La cohérence de ces trois voix conditionne la perception publique et judiciaire du dossier.
Le bon tempo : ni avant, ni après la justice
Avant
Trop de précipitation expose à l’erreur de fait.
Il faut parler quand les faits sont établis, pas quand ils circulent.
Pendant
Trop de silence nourrit les rumeurs.
Il faut donner un cadre, un ton, une méthode — sans commenter le fond.
Après
Quand la décision tombe, la communication doit être factuelle et respectueuse.
Ni triomphalisme, ni ressentiment.
Le ton juste : clôturer avec dignité, sans réécrire l’histoire.
Le message invisible : le respect de la justice
La meilleure communication judiciaire n’est pas celle qui “gagne” dans la presse.
C’est celle qui résiste dans le temps, qui n’aggrave pas la procédure et qui protège la réputation de long terme.
Une posture claire, cohérente, stable, respectueuse du droit finit toujours par être perçue comme une forme de vérité.
En communication judiciaire, la victoire n’est pas de convaincre tout le monde aujourd’hui.
C’est de pouvoir se représenter devant la justice demain, sans s’être trahi soi-même.
En résumé
Ce qu’il faut dire :
- Les faits établis
- L’esprit de responsabilité
- L’empathie sincère
- La coopération avec la justice
- Le respect des victimes et des salariés
Ce qu’il ne faut jamais dire :
- Les dénégations absolues
- Les attaques contre les institutions
- Les hypothèses non vérifiées
- Les confidences “off”
- Les phrases définitives et émotionnelles
En situation judiciaire, la communication n’est plus un outil d’image.
C’est un acte de gouvernance.
Dire trop, c’est fragiliser la défense.
Ne rien dire, c’est laisser la suspicion s’installer.
Dire juste, c’est démontrer la maîtrise, le respect et la transparence.
Parce qu’au bout du compte, la parole publique n’appartient pas à la communication :
elle engage la crédibilité, la dignité et la justice elle-même.