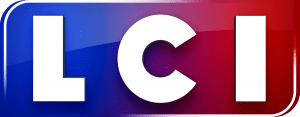Florian Silnicki, Expert en stratégies de communication et fondateur de LaFrenchCom’ était l’invité de LCI dans l’émission La Médiasphère présentée par Christophe Moulin. Cette émission s’intéresse aux médias, à ceux qui les font et ceux qui les regardent. L’émission affiche désormais un rythme quotidien et s’intéresse à l’univers des médias au sens large : TV, radio, digital, réseaux sociaux.
Florian Silnicki y décrypte la façon dont le terrorisme vit de la communication suite aux dramatiques évènements terroristes de Barcelone.